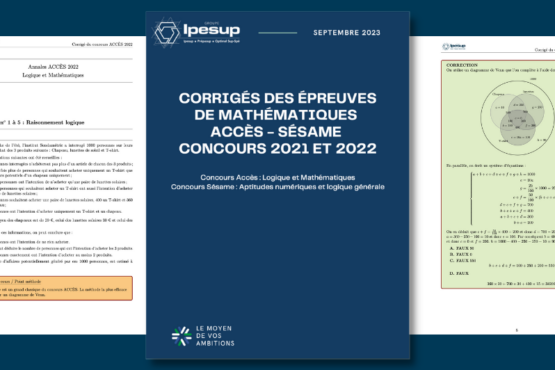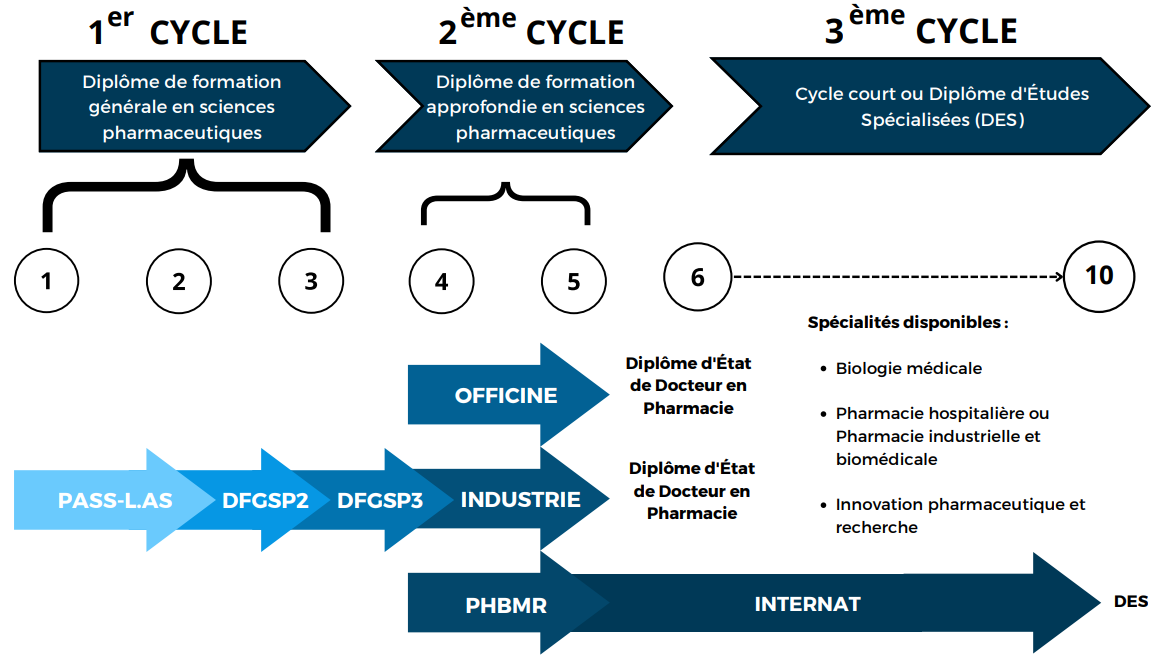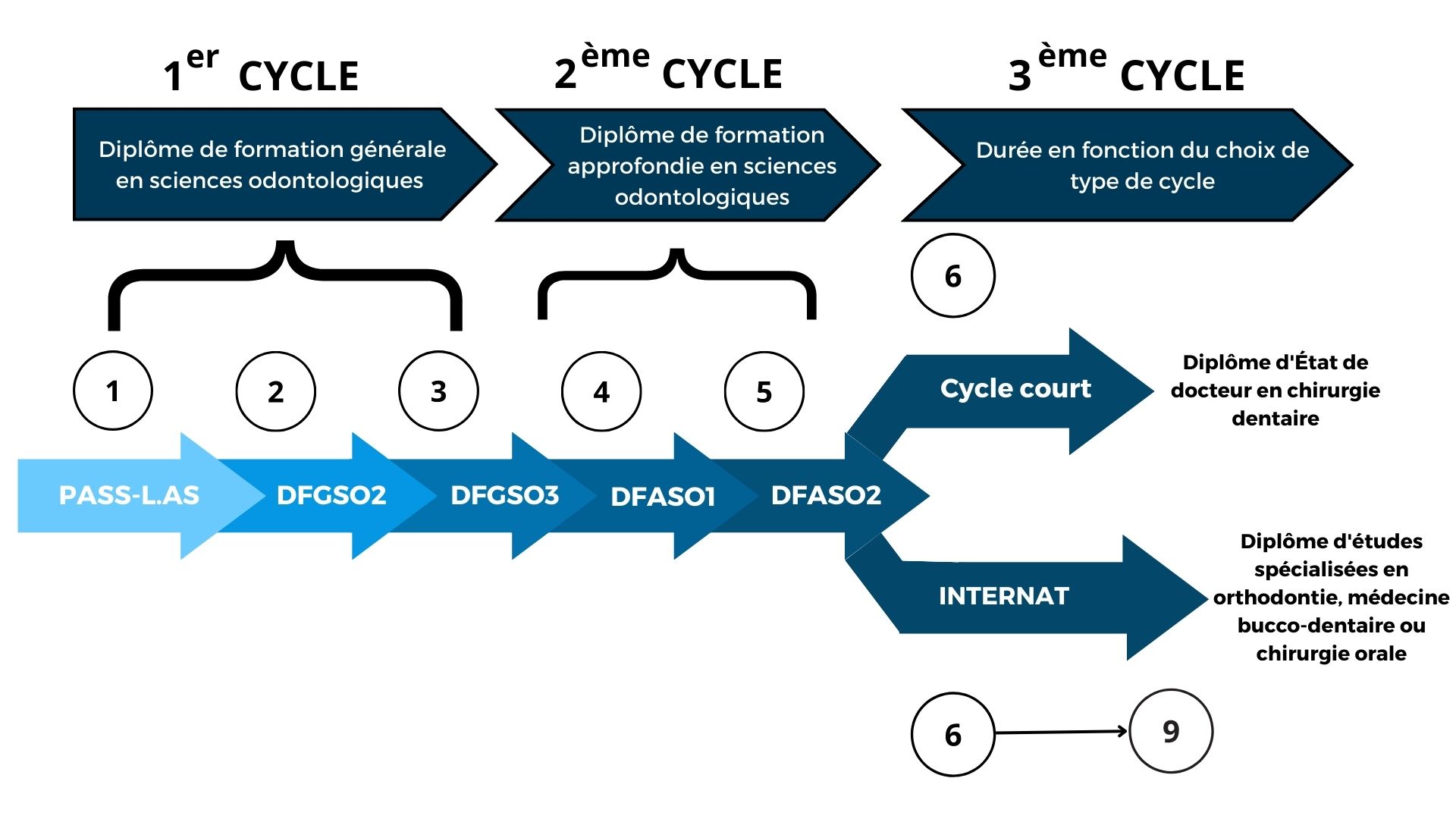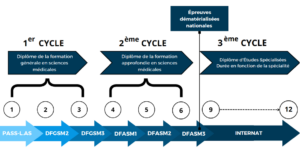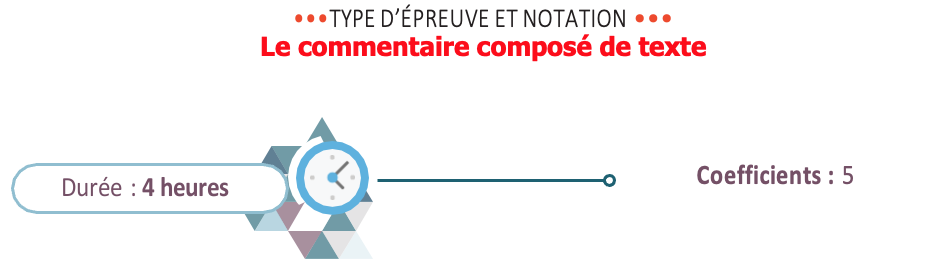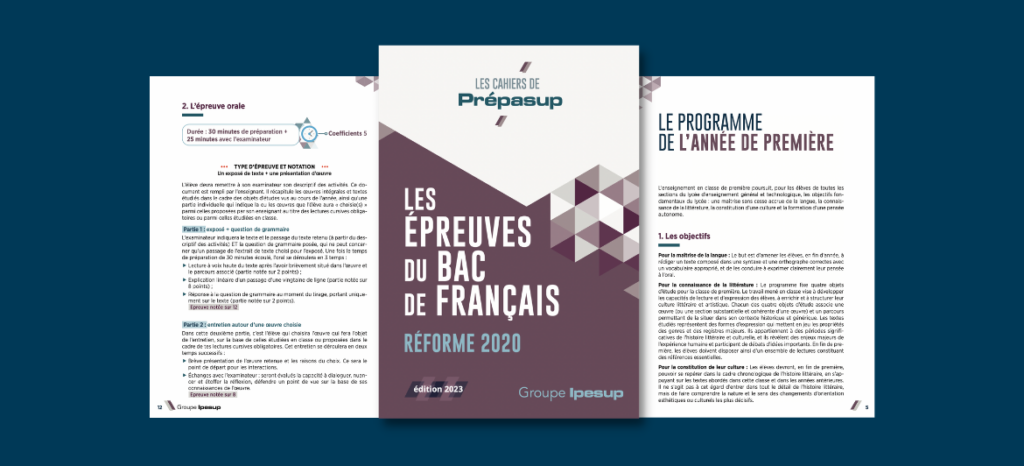Corrigés des concours SESAME – ACCÈS 2021 & 2022 – Épreuves de Mathématiques
Pour vous aider dans votre préparation aux concours d’entrée dans les écoles de commerce post-bac SESAME et ACCÈS, Ipesup met à votre disposition les corrections des épreuves de Mathématiques de 2021 et 2022.
Ce livret constitue un élément essentiel pour votre préparation individuelle, vous permettant ainsi de vous entraîner en toute autonomie. Une préparation rigoureuse permet aux candidats de se démarquer et d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir ces concours sélectifs.

 Guides et publications
Guides et publications